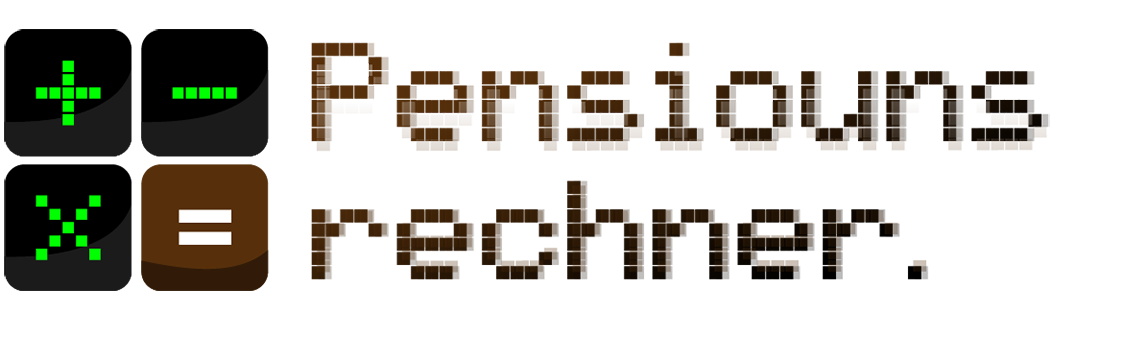Notre plan à cinq points.
Dans le débat sur le système des retraites, on voit déjà que le gouvernement CSV-DP, poussé par le patronat, prépare une casse sociale sans précédent. Contre cette attaque idéologique, déi Lénk propose un programme en cinq points qui non seulement préserve mais renforce le système.

Abolir le plafond de cotisation.
Actuellement, les personnes ayant un salaire élevé ne paient une cotisation que sur une partie de leur salaire, car les cotisations sont plafonnées à 5 fois le salaire social minimum. Nous voulons abolir ce plafond sans augmentation équivalente des prestations.

Etendre l’obligation de cotiser à tous les éléments du travail.
Sur certains éléments du travail, comme les heures supplémentaires ou les revenus professionnels de personnes ayant dépassé l’âge de 65 ans, aucune cotisation n’est prélevée. Nous sommes d’avis qu’il faut étendre l’obligation de cotiser à tous les éléments du travail. Les mesures 1 et 2 rapport 814 millions d’euros à la caisse des pensions.

Externaliser les frais et salaires de la CNAP.
Actuellement, les frais administratifs et les salaires de la Caisse nationale d’assurance pension, qui ne sont pas directement liés au paiement des pensions, sont payés par nos cotisations. Nous souhaitons que ces coûts soient externalisés, afin d’économiser environ 220 millions d’euros de dépenses.
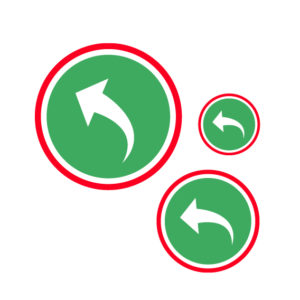
Annuler la réforme de 2012.
The 2012 reform automatically led to a deterioration of the pension system. We therefore wish to partially reverse this reform.

Augmenter la pension minimum au niveau du SSM.
La pauvreté des personnes âgées augmente rapidement, notamment parce que la pension minimale est inférieure au seuil de pauvreté. Nous exigeons une augmentation de la pension minimum jusqu’au niveau du salaire social minimum.